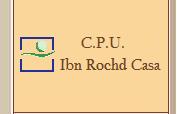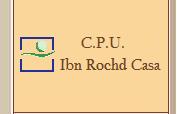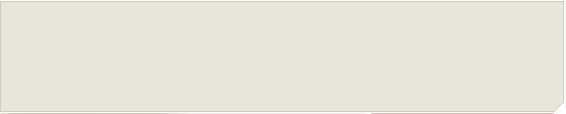Troubles des conduites instinctuelles et sociales
Troubles des conduites instinctuelles
1. Le contrôle sphinctérien
2. Le sommeil
§
Insomnie
ð
Insomnie totale
ð
Insomnie matinale
ð
Insomnie
d’endormissement
ð
L’inversion du rythme circadien
ð
La clinophilie
§
L’hypersomnie
§
Les perturbations de l’activité
onirique
§
Le mentisme
§
Les phénomènes hypnagoniques
3. Les conduites alimentaires
§
Anorexie et refus alimentaires
§
Les excès
alimentaires
ð
La sitiomanie
ð
La Phagomanie
ð
La voracité et la gloutonnerie
ð
La boulimie
ð
Les perversions alimentaires
ð
Le mérycisme
ð
Dipsomanie
ð
La potomanie
4. Les troubles du comportement sexuel
§
Troubles des conduites
sexuelles
§
Déviations sexuelles
ð
Masturbation
ð
Frigidité,
vaginisme
ð
Impuissance
Analyse de la conduite sociale
§
Les fugues
§
Les vois pathologiques
§
Les
homicides
Troubles des conduites instinctuelles et sociales
Troubles des conduites instinctuelles
Sont volontiers le motif d’une première consultation
5. Le contrôle sphinctérien
Est en général acquis avant l’age de trois ans. Certaines énurésies
persistent ou réapparaissent à l’âge adulte. La perte des fonctions
sphinctériennes doit d’abord faire penser à un trouble neurologique
En pathologie psychiatrique, ces troubles s’observent dans les
régressions mentales très prononcées gâtisme schizophrénique pouvant aller
jusqu’à la coprophagie
6. Le sommeil
C’est une interruption temporaire, périodique et réversible de la
conscience éveillée ; il n’est pas considéré comme un stade passif de
suspension de la vigilance mais comme une phase psychophysiologique active
dont témoigne les enregistrements polygraphiques (EEG, OCULOGRAPHIE,
ELECTROMYOGRAPHIE) et l’activité onirique ; le rêve gardien du
sommeil et garant de la modulation de la vie inconsciente
§
Insomnie
C’est un défaut qualitatif ou quantitatif du sommeil, elle peut être
initiale, matinale ou occasionner des réveils multiples au cours de la
nuit. Il en existe cinq types.
ð
Insomnie
totale
Elle est rare, s’observe uniquement au cours des accès maniaques des
confusions mentales, des sevrages d’alcool ou des hypnotiques et des
excitations délirantes
ð
Insomnie
matinale
Elle caractéristique des états dépressifs mélancoliques, en revanche
elle est banale chez le sujet âgée
ð
Insomnie
d’endormissement
C’est le réveil au cours de la nuit, se retrouvant dans les états
anxieux réactionnels ou des états névrotiques plus structurés
ð
L’inversion du rythme circadien
Somnolence de la journée et insomnie de la nuit, reste au cours des
confusions mentales, des syndromes démentiels et des syndromes
dépressifs
ð
La clinophilie
C’est le besoin de rester au lit toute la journée en somnolant plus
qu’en dormant. On la retrouve dans les schizophrénies hébéphréniques et
lors des dépressions
§
L’hypersomnie
Elle désigne une augmentation notable du temps sommeil, qui se prolonge
au cours de la journée ou encore les accès de sommeil irrésistible en
courts de la journée.
L’hypersomnie paroxystiques renvoie toujours aux pathologies du
sommeil, à savoir : la narcolepsie, syndrome de KLEIN LEVIN, syndrome
de PICKWICK et l’hypersomnie essentielle.
L’hypersomnie névrotique s’observe au cours des dépressions
psychogènes, chez des personnalités psychasthéniques ou hystériques afin
d’éviter les situations sociales.
A ne pas oublier d’éliminer d’abord une hypersomnie d’origine organique
(encéphalite infectieuses, traumatisme crânien, atteinte
tegmento-thalamique ou de la calotte protuberentielle…)
§
Les perturbations de l’activité
onirique
Décrites par le névrotique en terme de cauchemars, sont des sensations
terrifiantes dites (délire de rêve)
§
Le mentisme
Est un phénomène non pathologique qui survient au cours de
l’endormissement.
C’est un d’effilement d’images mentales incontrôlable, jugées par le
sujet étant anormales, elles surviennent au cours des états de fatigue, de
tension, ou d’anxiété.
§
Les phénomènes hypnagoniques
Surviennent lors du passage de l’état de veille à l’état de sommeil. On
décrit des phénomènes sensoriels ou psychosensoriels. Ces phénomènes
défilent comme un caléidoscope et ne sont pas intégrés dans un discours
délirant
7. Les conduites alimentaires
Boire et manger assurent la satisfaction des besoins nutritionnels mais
réactualisent aussi, à un niveau symbolique, les premières relations
objectales (stade oral). En outre toute une dimension culturelle est
impliquée dans la notion de repas : lieu et moment
Ont été décrits :
§
Anorexie et refus alimentaires
: l’anorexie
mentale
Diminution ou perte de l’appétit globale ou sélective, un désir de
maigrir (la préoccupation du poids parfois légitime est souvent
déraisonnable), on peut rapprocher de ces conduites les vomissements
provoqués, post prandiaux …
L’anorexie mentale de la jeune fille réalise un syndrome (anorexie,
amaigrissements, aménorrhée)
Le refus alimentaire ou sitiophobie se rencontre surtout chez les
mélancoliques pour lesquels renoncer à manger signifie, se châtier, se
laisser mourir, chez les délirants persécutés, qui pensent que la
nourriture est empoisonnée ; chez les schizophrènes, qui cherchent
dans le jeune une purification ou expriment un négativisme
§
Les excès
alimentaires
Peuvent être permanents ou paroxystiques :
ð
La
sitiomanie
Elle a un caractère impulsif, obligeant le malade à absorber des
quantités énormes de nourriture
ð
La
Phagomanie
C’est de manger entre les repas sans que la faim ne l’impose
ð
La voracité et la gloutonnerie
De certains débiles et déments peut être l’occasion de fausses routes
alimentaires
ð
La
boulimie
Sensation très intense de faim, vécu dans l’angoisse, contraignant
ainsi le patient à ingérer impulsivement une grande quantité d’aliments,
le désir de manger assouvi, apparaîtra en retour une sensation de
culpabilité et de dégoût. Ces états s’observent dans des états névrotiques
à domaine oral
ð
Les perversions alimentaires
Coprophagie
ð
Le
mérycisme
Rumination alimentaire avec ou sans régurgitation, s’observe chez
l’arriéré mental
ð
Dipsomanie
Besoin irrésistible de boire des boissons alcoolisées à fortes
quantités
ð
La
potomanie
Besoin impérieux de boire de fortes quantités de liquides, le diabète
insipide étant éliminé, provoquée par certains médicaments
psychotropes.
8. Les troubles du comportement sexuel
§
Troubles des conduites
sexuelles
Ne sont pas considérés comme pathologie en soi, en revanche peuvent
s’intégrer dans un trouble psychiatrique quand elles représentent un
symptôme : conduite masochique dans un contexte délirant, conduite
sadique dans la personnalité psychopathique ou psychotique
§
Déviations sexuelles
ð
Masturbation
N’est pathologique que quand elle est préférée à toute autre forme
ð
Frigidité,
vaginisme
Eviction des rapports frigidité vaginisme : absence de désir lors
du soit, le vaginisme est une contraction douloureuse des muscles du
vagin
ð
Impuissance
Peu spécifique, une cause organique est à éliminer
Analyse de la conduite sociale
Ils introduisent la notion de passage à l’acte, reflètent la
perturbation de l’individu dans un contexte relationnel avec son milieu
familial, professionnel ou social.
§
Les
fugues
Abondons du domicile ou du lieu de travail sans but précis
Les fugues inconscientes, amnésiques : épilepsie partielle
motrice, états seconds des névroses hystériques
Les fugues conscientes mnésiques : hallucinations menaçantes,
dissociation de la pensée (schizophrénie), accès maniaques ;
thématique délirante (voyage pathologique)
§
Les vois pathologiques
Ces vols sont rares en pathologie psychiatrique, en dehors des
personnalités psychopathiques et des vols secondaires la toxicomanie
Ils sont observés dans : les syndromes démentiels, les
schizophrénies, la névrose obsessionnelle et les épilepsies
partielles.
§
Les
homicides
Rare en pathologie mentale, s’observent dans
Les délires non dissociatifs
Les schizophrénies
Les accès délirants aigues
Les accès mélancoliques
L’alcoolisme chronique
L’épilepsie partielle psychomotrice
Les paranoïaques